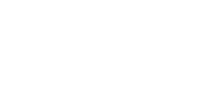A
Anonyme
Invité
La valse triste, de Jean Sibelius (1865-1957).

C'est pourtant l'été. Le ciel bas brumise une averse sur la terrasse. Une pluie fine comme les embruns, comme le sable, et qui, comme lui, s'insinue partout, colle partout. Je me suis installé sur les marches de la porte du séjour. Abrité par le balcon qui s'avance à l'étage, j'ai posé sur mes genoux le bloc prêté par Françoise, un grand bloc de papier blanc avec des lignes pour la correspondance. Il est interdit de fumer dedans. Dans ma main, le globe de cuivre gravé faisant office de cendrier est glacé, mais je sens à peine le froid contre ma paume. La faible lueur rouge de ma cigarette se ranime et éclaire mon visage quand j'en tire une bouffée. Il sont tous partis se coucher. J'aime ce moment et cette solitude. J'aime cette fraîcheur. Il faudra mettre un mot dans le livre de maison. Quelque chose qui me ressemble et qui leur ressemble. Quelque chose de nous.
Là, je suis à Pau. C'est mon appartement de quand j'étais étudiant, mon septième avec vue. C'est la nuit. Il ne doit pas être loin de trois heures du matin et, par la porte-fenêtre, je regarde les lumières de la ville endormie. C'est sans doute un peu bête, mais je m'imagine tous ces gens qui dorment à la lueur de mon regard et sur lesquels j'ai l'impression de veiller comme on veille un enfant, un amour. C'est drôle aussi comme je suis calme dans la nuit, comme mes inquiétudes s'estompent tout à coup. Qu'ils ont donc l'air fragiles dans le sommeil... Réduits par la nuit à n'être que ce qu'ils sont, qu'ils me semblent aimables soudain et comme je les aime. J'écris un poème. Il n'est pas très bon, mais c'est pas grave. Moi il me plaît bien.
J'ai 11 ans. On s'est donné rendez-vous derrière le réfectoire. À cette heure-ci, il n'y aura personne pour nous surprendre. J'ai le cœur qui bat assez terriblement, mais la curiosité l'emporte. Il faut absolument que je sache quel goût ça a. Il y en a qui disent qu'il l'ont déjà fait. Ça se trouve, c'est rien que des histoires. Mais elle, elle me plaît bien. Ce n'est pas la plus jolie, mais elle est marrante et sympa. Et puis c'est elle qui veut. Oh, et si elle ne venait pas ? Et puis je n'en sais rien moi, comment on fait en vrai. La voilà qui arrive. Elle porte son pull marin avec les lignes. Elle est belle comme un carnet de correspondance sur lequel on pourrait écrire de jolies choses, comme celui que maman a glissé dans mes affaires avec les enveloppes pré-timbrées et pré-adressées, au milieu des sous-vêtements étiquetés à mon nom. Elle approche son visage du mien, je sens son souffle, sa joue à l'odeur de savon, ses lèvres. Voilà. C'est fait. Une petite éternité de dix secondes. On se regarde vite fait et on ne sait pas trop quoi dire. De toute façon, on ne va pas traîner : il faut filer avant qu'on ne s'aperçoive de notre absence. Je suis un peu déçu, mais bon. Je m'attendais à autre chose, quelque chose de magique, quelque chose que j'aurais senti au plus profond de moi. Quelque chose qui soit comme dans le film du mardi et qui ne sente pas le savon. Mais bon, ça y est c'est fait. Les copains ne vont jamais me croire. C'est pas grave. Moi je sais bien que c'est vrai.

C'est pourtant l'été. Le ciel bas brumise une averse sur la terrasse. Une pluie fine comme les embruns, comme le sable, et qui, comme lui, s'insinue partout, colle partout. Je me suis installé sur les marches de la porte du séjour. Abrité par le balcon qui s'avance à l'étage, j'ai posé sur mes genoux le bloc prêté par Françoise, un grand bloc de papier blanc avec des lignes pour la correspondance. Il est interdit de fumer dedans. Dans ma main, le globe de cuivre gravé faisant office de cendrier est glacé, mais je sens à peine le froid contre ma paume. La faible lueur rouge de ma cigarette se ranime et éclaire mon visage quand j'en tire une bouffée. Il sont tous partis se coucher. J'aime ce moment et cette solitude. J'aime cette fraîcheur. Il faudra mettre un mot dans le livre de maison. Quelque chose qui me ressemble et qui leur ressemble. Quelque chose de nous.
Là, je suis à Pau. C'est mon appartement de quand j'étais étudiant, mon septième avec vue. C'est la nuit. Il ne doit pas être loin de trois heures du matin et, par la porte-fenêtre, je regarde les lumières de la ville endormie. C'est sans doute un peu bête, mais je m'imagine tous ces gens qui dorment à la lueur de mon regard et sur lesquels j'ai l'impression de veiller comme on veille un enfant, un amour. C'est drôle aussi comme je suis calme dans la nuit, comme mes inquiétudes s'estompent tout à coup. Qu'ils ont donc l'air fragiles dans le sommeil... Réduits par la nuit à n'être que ce qu'ils sont, qu'ils me semblent aimables soudain et comme je les aime. J'écris un poème. Il n'est pas très bon, mais c'est pas grave. Moi il me plaît bien.
J'ai 11 ans. On s'est donné rendez-vous derrière le réfectoire. À cette heure-ci, il n'y aura personne pour nous surprendre. J'ai le cœur qui bat assez terriblement, mais la curiosité l'emporte. Il faut absolument que je sache quel goût ça a. Il y en a qui disent qu'il l'ont déjà fait. Ça se trouve, c'est rien que des histoires. Mais elle, elle me plaît bien. Ce n'est pas la plus jolie, mais elle est marrante et sympa. Et puis c'est elle qui veut. Oh, et si elle ne venait pas ? Et puis je n'en sais rien moi, comment on fait en vrai. La voilà qui arrive. Elle porte son pull marin avec les lignes. Elle est belle comme un carnet de correspondance sur lequel on pourrait écrire de jolies choses, comme celui que maman a glissé dans mes affaires avec les enveloppes pré-timbrées et pré-adressées, au milieu des sous-vêtements étiquetés à mon nom. Elle approche son visage du mien, je sens son souffle, sa joue à l'odeur de savon, ses lèvres. Voilà. C'est fait. Une petite éternité de dix secondes. On se regarde vite fait et on ne sait pas trop quoi dire. De toute façon, on ne va pas traîner : il faut filer avant qu'on ne s'aperçoive de notre absence. Je suis un peu déçu, mais bon. Je m'attendais à autre chose, quelque chose de magique, quelque chose que j'aurais senti au plus profond de moi. Quelque chose qui soit comme dans le film du mardi et qui ne sente pas le savon. Mais bon, ça y est c'est fait. Les copains ne vont jamais me croire. C'est pas grave. Moi je sais bien que c'est vrai.