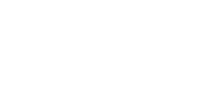Je suis dans un théâtre. Encore. Cette fois le théâtre est en plein centre ville, et la représentation se fait en matinée. Rien n'y est fait pour le public, et les véritables acteurs des histoires qu'on s'y raconte n'ont droit qu'à des strapontins, et à l'indifférence de ceux qui sont en scène. Seuls les concierges ont, pour ces pauvres erres, un tant soit peu de commisération.
Il faut dire que les murs impressionnent. Le public accède à l'intérieur par un escalier aussi monumental qu'extérieur, qui débouche sur des colonnes blanches. Là, l'escalier se resserre entre deux statues imposantes, deux grands acteurs historiques, natifs du pays.
Jean Bay, aumônier de Louis XIV, précepteur puis Premier Ministre de Louis XV. La justice dans sa version absolutiste.
Jacques de Cambacéres, ministre de la Justice de la Convention, deuxième consul du Directoire, archi-chancelier de l'Empire. Une autre justice d'exception.
C'est que ce théâtre si particulier, si froid, si silencieux, est celui de la Cour d'Appel de l'ancienne capitale des Etats du Languedoc.
Dans chaque salle, les pièces s'enfilent les unes après les autres. Avant chaque représentation,un homme en noir cravaté de blanc rappelle une partie de l'histoire dont le prochain acte a déjà commencé.
Fait rare, la scène qui se déroule sous mes yeux se joue avec un acteur amateur. Les professionnels de la profession le rappellent parfois aux usages, avec quelque condescendance. Les vrais acteurs, en écharpe d'hermine, maîtrisent leur langue, l'ordre des choses à présenter, manient la mauvaise foi ou le mensonge à l'occasion, créent une version des faits la plus convaincante possible pour le vrai public de la scène, les quatre hommes assis sur l'estrade, les juges.
Parfois, les acteurs se rapprochent de la tribune. Ils examinent des éléments que le public ne voit pas, interrogent des accessoires, tandis que l'audience tire l'oreille pour les entendre. Puis ils reprennent leur ballet, s'agitent, se rassoient, conciliabulent.
Dans la salle, l'audience est clairsemée, et chaque scénette n'intéresse vraiment que peu de spectateurs. Les autres attendent. Attendent leur tour. Attendent de raconter l'histoire des autres. Attendent que d'autres racontent leur histoire.
Il n'y a pas d'applaudissements. L'issue elle-même, la chute, n'interviendra que plus tard, dans le silence des couloirs du greffe.
Je pense à l'auteur de ce fil, rencontré quelques minutes hier. Je pense à écrire. Je pense à ne pas penser.
Le conseil de mon adversaire est une femme que je ne connais pas. Elle-même connait peu le dossier, visiblement, mais elle le plaide avec beaucoup de métier. Elle parle à la place de mes anciens patrons. Elle essaye de convaincre les juges qu'ils n'étaient pas mes patrons. Ou alors, que si ils l'étaient, c'est nous qui sommes partis de notre plein gré.
Nous.
Nous sommes trois. Unis, en bloc, depuis des années. Nous sommes bien, entre nous. Rien ne passe, rien ne nous a fragilisé. Nous sommes une équipe. Soudée.
Il n'y a plus que nous, nous sommes les derniers dont on racontera l'histoire aujourd'hui.
Notre avocate est une tigresse. Elle essaye toujours de déstabiliser son adversaire par un coup de griffe, un ricanement. Les deux femmes nous jouent une scène connue, un classique des prétoires. Les deux félines en bataille.
Le public en noir s'en amuse, puis s'en lasse. Il écoute. Pose des questions. A nous. C'est la première fois que l'on nous demande ce que l'on fait. Nous nous levons, l'un de nous prend la parole. Ce n'est pas moi. Les mots ne sont pas sortis de ma bouche assez vite.
L'avocate conclut. Les juges remercient. Délibéré dans six semaines. Ils saluent les dames en noir. Pas nous. Nous, nous n'existons déjà plus. C'est fini.
La tension est forte, l'attention se relâche. Je n’ai envie de rien d’autre que de chaleur. C'est une épreuve de froideur et d'inhumanité. Nous sommes étrangers à ce monde dans lequel nos histoires se racontent et se rangent et se jugent.