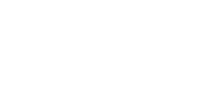J'aimerais revenir sur une photo récente de Jura qui a suscité quelque controverse par son affichage intial aux «Cimaises» :
Aperçu de
Saint-Claude, par
Jura

Mon absence radicale de compétence
technique en matière de photographie m'empêche de juger ce qui aurait pu intervenir, en
amont d'un cliché, pour qu'il ait un meilleur
rendu. Ni si des manipulations
a posteriori peuvent corriger ce
rendu. Je suis condamné à la position de l'éternel
débutant : celui qui
part de ce qui lui est donné à voir,
tel quel, pour laisser s'en produire des
effets sur l'imagination. J'assume donc la donnée brute du
brouillé des teintes de ce cliché comme s'il s'agissait d'un de ces daguerréotypes sur verre où le
délavé des couleurs donne un effet de
patiné.
Le «
patiné » (qui se traduit aussi bien par «
rouillé ») est le concept du poète japonais
Bashô pour désigner le
rendu global d'un
haïku (petit poème de 3 lignes en 17 syllabes) - le «
sabi ». Un
haïku offre un
rendu «
patiné » lorsque s'y superposent les deux dimensions du «
per-manent » et du «
fluent ». C'est l'impression que fait sur moi cette image de
Jura.
Sous les ponts, coulent les rivières.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Et nos amours
Faut-il qu'il m'en souvienne
La joie venait toujours après la peine
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
Les mains dans les mains restons face à face
Tandis que sous
Le pont de nos bras passe
Des éternels regards l'onde si lasse
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
L'amour s'en va comme cette eau courante
L'amour s'en va
Comme la vie est lente
Et comme l'Espérance est violente
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
Passent les jours et passent les semaines
Ni temps passé
Ni les amours reviennent
Sous le pont Mirabeau coule la Seine
Vienne la nuit sonne l'heure
Les jours s'en vont je demeure
Ce poème d'
Apollinaire montre bien comment, d'ordinaire, intervient l'effet de «
patiné » suscité par la rencontre : pont / rivière. Le point de vue est toujours celui de quelqu'un arrêté en haut du pont, qui contemple le flux de la rivière qui s'écoule transversalement en contrebas . Si l'image de
Jura provoque en moi un puissant effet d'imagination, c'est que son «
patiné » prend exactement le contrepied de ce dispositif (poétique) traditionnel.
Car c'est à partir d'une position arrêtée en contrebas, que le regard s'élève sur l'enjambement transversal du pont. L'aube rouillée de la grande roue d'un moulin : elle ne tourne pas. Elle est arrêtée comme celle d'un temps qui ne s'écoule à aucune horloge. Un verdoiement
diffus de feuillages d'arbres l'enveloppe dans sa permanence, qui est la perdurance même de la Nature. La rivière que l'on ne voit pas, d'être évoquée dans son absence même, perd le caractère de l'écoulement pour prendre celui de l'immobilité : elle ne s'écoule pas, cette rivière que je ne vois pas, mais elle dure à l'image de la durée du paysage. Ce n'est pas la rivière qui s'est absentée, c'est l'idée d'écoulement qu'on lui associe d'en haut des ponts.
Comparée à cette permanence naturelle, l'enjambée grise du pont de béton lancé tout là-haut, parmi les nuages d'un ciel blafard, évoque une sorte de
Zeppelin aérien prêt à disparaître du tableau à peine larguées ses amarres. Pont en pleine esquisse du geste de s'en aller, pour suivre l'écoulement des nuages. Non sans faire planer le plomb d'une menace sur cette plaine d'innocence.
Cette image refait surgir en moi un souvenir d'enfance à la campagne, chez mes grands-parents, dans les
Landes. Dans la Forêt, coule la rivière
Leyre. Un moulin à aube abandonné est bâti le long d'un bief, qu'un barrage en travers de la rivière permettait d'alimenter. Un pont couronnait le barrage. Le barrage s'est rompu, mais l'arche du pont est demeurée en suspens : on l'appellait le
Pont Cassé. Le bief n'a plus que des eaux mortes. L'aube du moulin ne tourne plus. Enfants, moi et d'autres paÿs, nous regardions souvent du haut du
Pont Cassé en arrêtant nos bicyclettes la rivière
Leyre couler en contrebas. Un jour, j'ai eu l'idée de descendre au bord de la rivière, en désescaladant la pente abrupte menant du niveau du pont au fond de l'encaissement des eaux. Assis sur la berge de sable roussi, observant des ablettes minuscules se maintenir immobiles dans l'eau de la rivière ensablée sans courant perceptible, j'ai levé les yeux vers le tablier du pont de béton, en partie fracturé, tout là-haut au-dessus de ma tête : par rapport à la permanence immobile de la rivière, des ablettes, du sable de la berge, de moi-même assis sur cette « berge de l'éternité » - j'ai
découvert le pont comme fait de l'étoffe même du
temps : simple moyen de
passer la rivière, d'échapper ce milieu de permanence naturelle, projet ruiné : le
Pont Passé. Les ponts de béton que j'avais cru durables, je m'y suis vu
passer au passé depuis ce contrebas d'éternité de la rivière.
Enfance
retrouvée re-
jurée, qui avait failli s'échapper dans le temps.