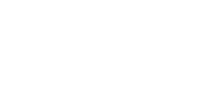Ma D. chérie.
Tu es partie ce matin, au lever du jour, dans un dernier souffle au fond de ce corps diminué, recroquevillé.
Et je n'ai toujours rien préparé.
Sept longues semaines d'une extinction lente, pendant lesquelles ta volonté a parfois faibli devant ton extraordinaire force de constitution. Tu voulais mourir, mais ton cur, lui, ne voulait pas lâcher. Le fourbe.
Lui qui ne t'a jamais trahi, il semblait te faire faux bond, refuser de se plier à ta dernière volonté.
La volonté d'une toute petite bonne femme de quatre-vingt dix sept ans, qui a vu naitre et mourir ce siècle de toutes les expérimentations, de tous les bouleversements.
Je n'ai rien préparé d'autre que moi. Tout est dans les cahiers, là bas, en haut. Ta vie, comme des pages noircies à t'écouter, assis sur un des fauteuils de ton salon, avec un thé et des petits fours.
Ces heures dans le salon, avec le buste de Beethoven posé sur le demi-queue pour seul témoin, c'est un des plus beaux cadeaux que tu m'aie fait. Avec la Bible illustrée par Gustave Doré. Ta bible de païenne qui l'est en connaissance de cause.
J'emmène ma fille, la grande. Elle veut te rendre aussi hommage.
Et chérir ta mémoire. Et réconforter ta fille, que tu as bien éprouvé ces derniers jours.
Elle ne t'en veut pas, elle est soulagée, tout comme nous.
Ma mère. Ta fille. Que tu appelais Madame, depuis tant d'années déjà.
Je ne veux pas dépérir comme toi. De ce que je puise en moi aujourd'hui, je veux construire la force de mettre moi-même fin à mes jours si d'aventure la vie, cette salope, voulait me réserver le même tour. Cette mort lente de l'esprit.
"La mort est une affaire de vivants", disait le vieux Norbert Elias. Il m'a bien aidé, celui-là.